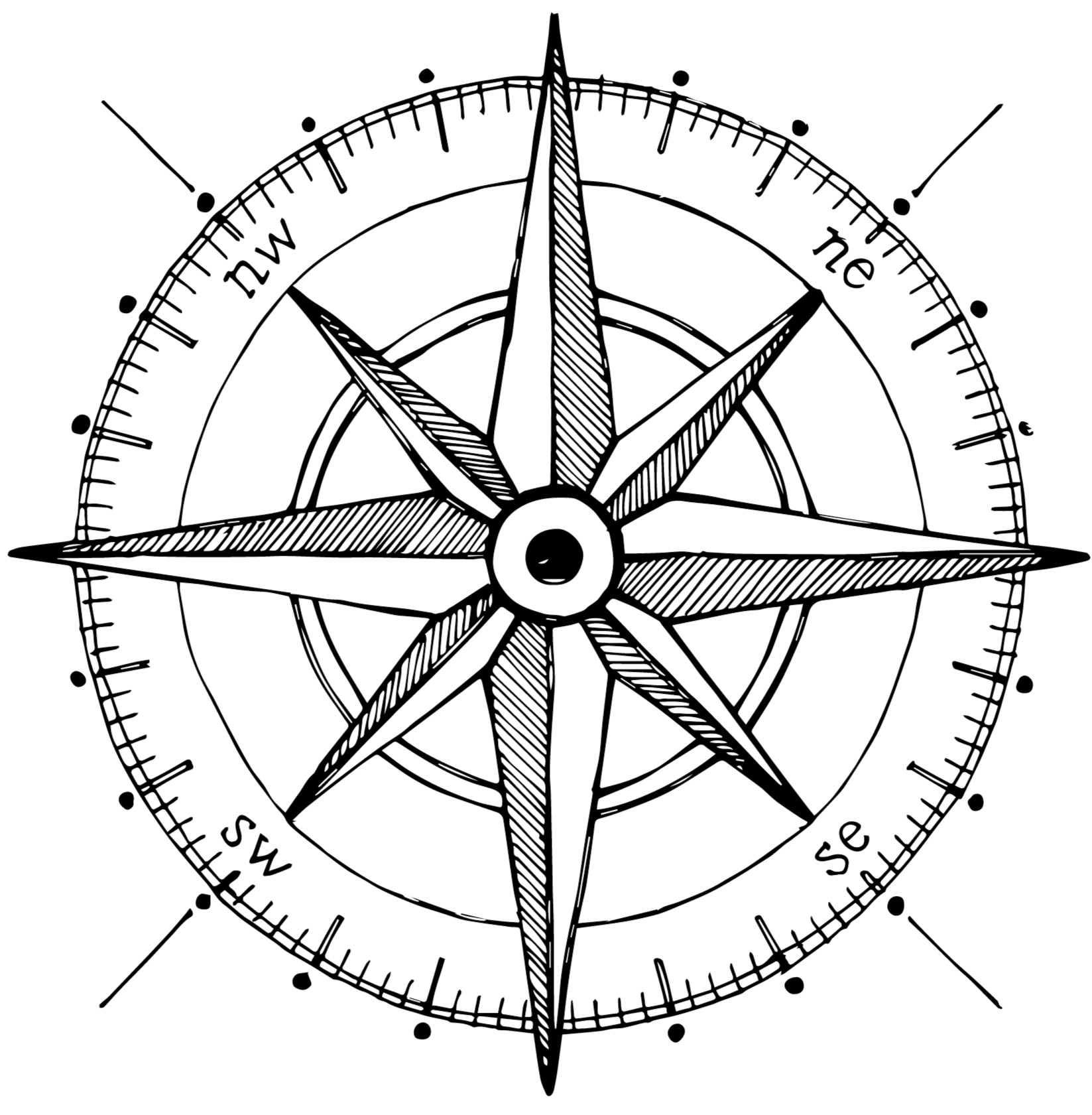
vivre fatigue, mais mourir tue
Quatre étudiants de la faculté de Droit, un peu éméchés d’avoir bien fêté le Réveillon du 31
décembre, regagnent la Cité-U en longeant le Parc Jourdan. Ils ne trouvent pas comme
souvent un homo ou deux à dérouiller. Ces enflures traînent là nuitamment pour s’aimer les
uns les autres. Quand ils rencontrent nos quatre futurs magistrats au sortir de nouba, ils sont
contents du voyage. Raclée, insultes, crachats, c’est la rumba.
Un peu frustrés, nos quatre amis se défoulent sur une bicoque de tôles, de cartons et de
chiffons échouée lamentablement sur un terrain vague, sous le pont de chemin de fer, une
friche laissée vacante entre la passerelle qui relie la Cité Universitaire à la fac, les somptueux
ombrages du Parc, et le site d’un improbable chantier de construction à l’abandon où nul n’a
mémoire de ce qui devait pousser là.
Dans ce tas de tout et de rien, un clochard sans âge, sans figure, puant comme pas deux, règne
en Maître. Pour fêter la Nouvelle Année, les étudiants mettent le feu avec joie au piteux
logis, arrosé d’un fond de vodka agrémenté d’un zestounet de tequila. Faute de rosser des
pédés, roussir un clochard, certainement sans papier, ce qui ne facilite pas la mise à feu, c’est
une excellente initiation à leur future carrière.
Pur hasard, trop éméché lui-même la veille, gros rouge et demi-pression accumulés, le
clochard n’a pu parvenir jusque-là, il tombe à plusieurs reprises en traversant le chantier
déchu dans l’obscurité, les pieds pris dans des câbles rouillés. Il rampe jusqu’à un tuyau de
béton assez large pour y passer la fin de la nuit, il fait fuir un rat.
Au 1 er janvier tôt matin, il contemple le désastre, il trouve ça un peu chelou. Il a son point de
vue. Un S.D.F. n’a pas de domicile, c’est logique, il y a la logique à respecter. Il a
copieusement dégueulé une partie de la nuit, il pue pire que l’année précédente, les vêtements
gluants l’ennuient. En farfouillant autour des cendres fumantes, il retrouve à l’écart un sac
plastique contenant une veste de costume gris bien coupée, et un panta short de sudation en
néoprène, l’une récupérée au Secours Catholique et l’autre sur le corps d’un cycliste. Il
abandonne les vêtements souillés. Avec une belle veste, démunie de boutons, ouverte sur une
maigre poitrine nue et un bermuda noir moulant il quitte les lieux, aux pieds des tongs en
plastique, très chics et colorés jaune pastel pour la semelle, orange dynamique pour l’attache
entre les orteils. Pas de crainte, le froid, le ridicule, l’avenir, il ne craint pas, ne regrette pas
l’abri. Il râle dur.
Il chemine avenue Abram, peste comme un sauvage triste, peu lui chaut la perte du gîte, il râle
après l’emplacement, il n’osera pas retourner. Incendie, maladresse, accident aucune idée, il
ne sait pas, il est coupable point, on ne va pas chercher point, punir point. Peste. Il aime cet
endroit.
La proximité du chantier lui convient, il y renifle un passé de conducteur de gros engins,
métier exercé une dizaine d’années, jusqu’à ce qu’à un trop boire ou à un trop fatigue il perde
le contrôle, tombe au sol et passe sous une roue plus haute et large que lui. Après des
opérations, de l’hospitalisation, de la rééducation, il sort avec un œil en moins, une épaule
tordue, une hanche folle qui lui fait une patte plus courte que l’autre, la gueule raccourcie à la
mâchoire ne lui permet plus d’articuler correctement. La femme ne supporte pas, bien avant la
fin de la convalescence, fuit avec les deux enfants, interrompt la location du domicile familial
sans prévenir, met en route une procédure de divorce, empoche les différentes primes et rentes
auxquelles il peut prétendre. Les sous, il ne sait pas très bien ce qu’ils sont devenus, peu
importe. Il ne se rappelle plus s’il boit déjà avant l’accident, ou si l’outrance vient au départ
de femme et enfants. Sur le chantier, professionnel, on lui dit « Monsieur ». C’est bien, un
souvenir. Le temps passe, le « Monsieur » répété avec respect se réduit à un gargouillis.
Peu importe. Il aime le chantier.
L’endroit lui plaît à côté de la Cité – U. Au ventre de la nuit, des étudiantes, seules ou en
groupe, traversent le terrain vague pour éviter un long détour. Il repère les traces de pas qui
font chemin, herbes écrasées, boue remuée, toujours le même passage. Il observe, curieux, il
prend l’habitude, quand l’alcool ne le fait pas sommeiller, de monter la garde là, pantalon
baissé et zizi à l’air. Quand une jeune femme s’approche, il l’agite et grommelle « Touche,
viens toucher, s’il te plaît, touche … ». Souvent les filles ne voient pas, n’entendent pas. Ou
rebroussent chemin, renoncent au raccourci. Les récidivistes éclatent de rire, lui lancent un
gentil « Eh ben, t’as sorti le grand jeu aujourd’hui », ou un désinvolte « Remballes moi tout
ça, tu vas me l’enrhumer ». Il trouve, pour passer moins inaperçu, une lampe torche, un soir
d’été il illumine les parties basses dénudées à l’approche d’une proie. C’est une punkette qui
débarque, il écope d’un formidable coup de pied au bas ventre (rangers BMJA ferrés, taille
40). Il a mal. La punkette pique la lampe torche toute neuve.
Perdre, pour un feu de rien, cette bonne sociabilité, il rage. Il rumine. Parvenu à la Rotonde,
il observe un graffiti sur une façade. Il déchiffre. Ce doit être « Toute personne qui naît sur
terre est en situation régulière » ou quelque chose comme ça. Il n’est champion ni de lecture
ni d’écriture. Il gratte tête avec des doigts sales, poitrine, avec les ongles, rageusement rigole,
il y a des abrutis pour écrire des salades, il crache. Il stationne devant une boutique de
vêtements Olly Gan, la vitrine est recouverte d’affichettes fluo jaunes et orange, sur les unes,
« Soldes » sur les autres, « Tout doit disparaître ». A deux pas, un superbe magasin Celio, il
n’y a pas écrit que « Tout doit disparaître ». Ils ne sont pas d’accord entre eux.
Il bifurque vers la route de Marseille, ne croise personne, passe devant la Poste, il a le
sentiment que la jambe folle un peu plus courte le fait tourner en rond, revenir au point de
départ, ça énerve. Il rumine contre ce mec qui naît quelque part en situation régulière et
puis quoi. Il est né, lui, on a raconté que le père et le grand père se répandent dans le village,
boivent des coups chez les voisins en criant « Ali est né, Ali est né ». Ils ne le taguent pas sur
le mur aux yeux de n’importe qui, ils parlent aux gens du village. Il longe le chemin du Petit
Barthélémy, il ramasse un galet, grave sur un mur d’enceinte « Ali é né », mécontent du
résultat il tente d’effacer, il essaye autrement, jette le galet contre le mur et galope, il galope
devant l’Uniprix, récupère une grappe de raisins blancs amochée au milieu d’un tas de
détritus qui attendent la benne. Du raisin un premier janvier, c’est luxe. Il stationne sur un
banc à l’entrée de la gare SNCF, pratiquement déserte, reprend son souffle. Il distingue, dans
la salle des pas perdus, un corps immobile, ou plutôt deux corps ensemble, deux corps,
avachis sur une banquette, accolés l’un à l’autre, mais deux corps avec une seule tête, oui,
deux corps, avec une seule tête, une seule. C’est un corps ou deux corps, quand il y a une
seule tête. Curieux, il pénètre à l’intérieur de la gare, à quelques mètres du monstre qui
sommeille. Il ne sait pas bien lire, pas bien écrire, il sait compter. Il compte quatre jambes,
moulées dans des jeans délavés, quatre bras et deux torses, enserrés dans deux blousons de
cuir Unisexe plutôt mode, il compte quatre pieds garnis de Nike, il gratte la tête et la poitrine
sous la veste grise bien coupée, très fort, sous les seins, avec les ongles, il a mal aux pieds. Il
ramasse les jambes sous lui, abandonne les tongs au sol, il passe son index entre chaque
orteil, ça chasse un peu de crasse et ça délasse. Il scrute la tête unique, qui ne bouge pas, un
simple va – et –vient lié à la respiration, ça dort et ça respire, énorme boule de cheveux
crépus, une grosse boule de poils noirs frisés style Angela Davis ou, mieux, une énorme tête
de loup pour chasser les araignées au plafond, le plafond d’une maison, il y a longtemps,
enfouie là, il y a longtemps, une maison, mais c’est vrai. Il continue à observer, il observe, il
cherche et ne trouve pas de visage, il voudrait compter les yeux et les bouches, peut-être un
seul œil au milieu du front, peut-être pas de bouche, il mâchonne un peu de raisin et sans
quitter des yeux la grosse boule de poils, crache par terre les grains trop pourris qui
s’agglutinent sur les tongs. Le passage rapide d’un train réveille le monstre, la boule de poils
noirs se redresse, les visages d’un joli gars et d’une chic fille en sortent, unis l’un à l’autre de
sommeil et de tendresse, s’écartent l’un de l’autre sans totalement se décoller, reprennent un
peu d’autonomie, pas trop. « Tu vas, Anaïs ? Tu n’as pas froid ? ». Elle s’ébroue, agite
négativement la tête, ils se redressent, main dans la main, un temps maintiennent un reste du
monstrueux accouplement, refont le coup de la tête unique le temps d’un court baiser, quittent
la Gare, escaladent un scooter rouge bien usagé fabriqué par Peugeot en 1997, quelques
pétarades de moteur enroué, un mal fou à caser les épaisses toisons noires à l’intérieur des
casques, ils s’éloignent vers l’avenue Abram. Il veut les suivre, il cherche les tongs,
baragouine un incompréhensible « Merde, attends, Anaïs, merde, mes tongs ». Les pieds
collent au mâché de raisin craché tout à l’heure, il crie, se redresse, crie « Anaïs, viens,
putain, viens nettoyer mes tongs, merde, agenouilles – toi, viens, viens toucher, tes mains,
doigts, ta langue, Anaïs, pute ».
Un employé casquetté des chemins de fer surgit, contemple épouvanté le désastre claudiquant
et couinant, lâche un furibard « Casse – toi, pauvre con » très à la mode. L’employé est mode
et Ali est colère, il repousse l’employé, abandonne les tongs et saute sur les voies, ne
s’écorche pas les pieds trop endurcis pour un ballast trop tendre où nul ne le poursuit, il
galope et crie encore « Anaïs », une seule fois. Il court vers le chantier, il grimpe sur un
terre-plein, se penche sur la voie, le Trans Express Régional de toute beauté qui commence à
ralentir aux approches de la Gare est aussi magnifique qu’Anaïs. La tête, grattée, la poitrine,
sous les seins, grattée, avec les ongles, il lui crie, en basculant lentement vers elle « Anaïs,
viens toucher, Ali est né, Ali est né ».
Après trois heures de perturbation, sous l’autorité compétente du Procureur de la République
poliment fâché mais fâché tout de même et quand bien même tout à fait fâché d’être dérangé
le Jour de l’An, « La Loi devrait interdire les suicides les jours fériés », tout rentre dans
l’Ordre. Le T.E.R. bloqué plus de deux heures, les voies sont soigneusement nettoyées, les
morceaux de corps éparpillés respectueusement assemblés dans des sacs neufs prévus à cet
effet, les rudes limiers du Commissariat d’Aix – en –Provence tout émoustillés de ne pas
retrouver trace de chaussures, « Qui aurait donc transporté le corps jusqu’ici pour le jeter
ensuite sur les voies », le chauffeur traumatisé du TER remplacé par un autre mécano tiré du
lit, conformément aux usages les voyageurs immobilisés mécontents résignés empêchés
d’abandonner le train malgré la proximité de la gare, « La SNCF, si c’est pas les grèves ou
l’aiguillage, c’est toujours pareil, on nous prend en otages », pourtant ils ont été assez
rapidement informés des regrets de la Société Nationale contrainte d’ interrompre le trafic
contre sa volonté suite à la présence sur la voie d’un corps non identifié.
A la mi-journée, tout le monde ayant bien œuvré, Ali laisse, déchiqueté, moins de traces
dans la cité que quelques grains de raisins écrabouillés sous quelques pas perdus de rares
voyageurs, made in France pour quelques-uns d’entre eux, qui ne vont pas tarder à rejoindre
l’une des stations de ski du Dévoluy, du Haut –Champsaur, de l’Ubaye et de la Vallée de la
Blanche.