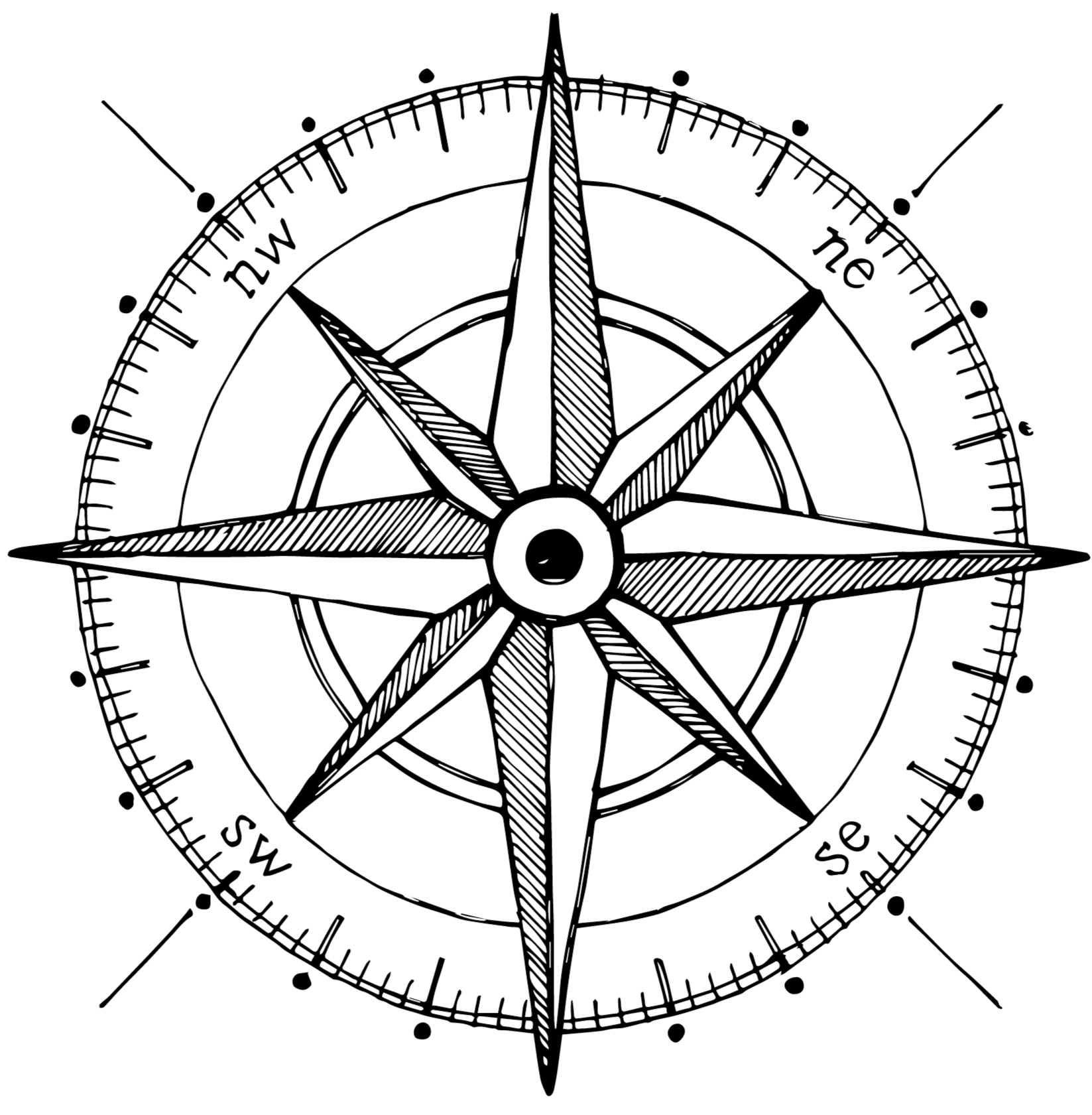
toute personne née sur terre y est en situation régulière. Toute personne née sur terre y est en situation régulière.Toute personne née sur terre y est en situation régulière. Point barre !!!
La soirée improvisée entre copains dans la propriété des parents de l’un d’entre nous, en
banlieue lyonnaise, s’annonce comme un vrai régal.
J’ai seize ans, pas encore seize ans, dans deux mois seulement. Nous sommes en septembre
68, autant dire mai. Évènements à durée indéterminée avec parfum d’éternité, c’est ce que
nous sentons pour la plupart d’entre nous, quelques jours encore. C’est toujours le cas pour
moi, cinquante ans après. J’ai, en guise d’oxygène, du mai 68 plein les poumons pour
quelques milliers de vies présentes et à venir.
Le monde en bougeant ce printemps-là a créé comme un courant d’air que je sens sur ma
peau quand je respire, dès que je m’aperçois que je respire, dès que je décide de respirer, et les
poils de mes avant - bras s’agitent, tremblement de bonheur rare et d’inquiétude.
Je suis le seul à voir mes poils bouger.
C’est imperceptible, c’est indéfinissable, c’est plaisant, ce mouvement d’air là. C’est
extrêmement pratique, en quelques jours la fin de mon enfance, mon adolescence, et comme
un début de jeunesse qui tarde à me quitter. Pendant trois semaines la planète comme tréteau
pour y jouer publiquement mes farces, sans autre metteur en scène que toutes mes illusions,
sans aucun autre dialogue que celui d’amour d’avec liberté. Je marche dans la rue, je suis la
Commune de Paris, la Révolution d’Octobre, Barcelone en 36 et je porte des valises en 1958.
Grâce à des dizaines de millions de gens, en Allemagne et au Mexique, au Japon et aux Etats
– Unis, à Berlin et à Rome et à Londres et à Paris.
A soixante cinq ans, et au milieu d’un fatras d’incertitudes, ne réussis pas encore à mettre la
moindre poussière sur tout ça. Aucun ordre ne s’y est établi.
Mon père, cadre dans une société pétrolière, affolé de mon engagement dans les évènements
du printemps s’est persuadé que mon comportement est du à de mauvaises fréquentations. Il
demande sa mutation en express à son employeur. Dès le mois de juillet nous quittons Lyon,
ou plutôt Villeurbanne, et le lycée rouge de mes extravagances, pour retourner sur Marseille,
notre ville natale à mon père et à moi, et où celui-ci me trouve plus en sécurité, loin des
agitateurs qui lui ont quelques semaines volé son enfant.
L’arrachement brutal à mes amis lyonnais, relativement douloureux, ne me perturbe pas plus
que ça. La révolution étant d’une part universelle, d’autre part imminente, peu importe que je
sois à Lyon, à Marseille, ou à Pampelune, les réactionnaires de tout poil me trouveront
inéluctablement sur leur chemin, et la séparation sera de courte durée d’avec mes frères
d’armes. C’est plutôt du côté des sœurs que j’ai quelques écorchures. J’ai un petit regret, non
pas d’avoir laissé aux vestiaires pour un temps Bakounine et Ho Chi Minh avec Louise
Michel et Makhno, mais de me retrouver écarté un peu trop tôt de la grande Evelyne, longue
et souple et brune Evelyne, ou de la toute menue Sylvie charnelle et pétillante, sans oublier la
tant désirée Isabelle, ou la surprenante Claire, toutes approchées, toutes enflammantes, et qui
sauront vite se consoler de ma disparition. Car à quinze ans et demi et compte tenu d’un
certain retard à l’allumage qui me poursuit auprès des femmes depuis que je suis sur cette
terre, et malgré l’explosion de libertés qui me submerge à l’époque, j’ai beaucoup approché,
beaucoup tâté, beaucoup flirté, beaucoup espéré, et rien osé ni abouti.
Ah, toute menue Sylvie charnelle et pétillante, me revient souvent au cœur à l’âme et bien
plus souvent encore à d’autres endroits que rigoureusement ma mère m’a interdit de nommer
ici cette virée en bagnole dans les rues lyonnaises, où le chauffeur voulut nous démontrer son
savoir-faire, il est vrai que depuis il remporta quelques championnats de course automobile, et
comme nous étions sept à bord de cette Dauphine au moteur surdéveloppé mais aux places
limitées, vous dûtes, alors que nous croisâmes de la maréchaussée motorisée, disparaître de
sa vue en vous couchant sur mes genoux, la tête exactement déposée dans le creux de mes
cuisses, s’appuyant comme c’est pas permis là où j’eus exactement voulu qu’elle se fût
appuyée si l’on m’eut demandé mon avis sur le sujet. Je vous enveloppai d’un bras protecteur,
vous faisant croire pendant plus d’un délicieux quart d’heure à la présence de la maréchaussée
à nos trousses, alors qu’ aussitôt vue aussitôt disparue, celle-ci ne se soucia pas un seul instant
de nous, et quand vous vous aperçûtes de la supercherie, depuis un moment déjà je vous
massai vigoureusement d’une main très émue la hanche gauche pour faire passer une
prétendue crampe, et vous vous relevâtes d’un simple sourire entendu en constatant l’émoi de
mon entrejambe, souligné d’un « oh, Renato, on se calme, on se calme », ponctué d’un
claquement sec de vos mains comme pour me dire « ce n’est pas l’heure ». Il fallut bien que la
ballade eût une fin, et malgré toutes nos promesses de libération mondiale le respect des
horaires imposés par nos parents respectifs nous contraignit à une séparation précoce. Le
hasard, et mes peurs, firent que nous ne nous croisâmes plus avant mon départ forcé pour le
midi. Je quittai Lyon avec le fol espoir de vous retrouver un jour, couchée sur mes cuisses,
avec une petite demi-heure de plus que la première fois.
Donner du temps au temps, mais le plus tôt possible, foi de la colonne à Durutti.
Ce vouvoiement ci-dessus-tilisé n’est pas que littéraire, Sylvie fut une rare copine vouvoyée
toujours, le tutoiement eut été la preuve entre nous d’un accomplissement qui n’eût lieu, le
vouvoiement comme le passé simple que voulez-vous allaient bien à son teint, à sa croupe, et
conviennent à ma souvenance.
Exilé donc à Marseille, grâce à la poigne parentale, dès les premiers jours de juillet j’
embauche sur les quais comme garçon de courses chez un transitaire, un homme adorable, un
patron pourtant mais je ne suis pas à une contradiction près dans mon éducation politique.
Pour mon père, qui a vu juste en partie, ce contact direct avec le monde du travail me
changera les idées le temps de l’été et me rendra plus raisonnable lors de la rentrée scolaire,
dans ce lycée renommé, tranquille et bourgeois où il a eu le plus grand mal à me faire inscrire
en classe de seconde, étant donné mes antécédents.
Quand mon transitaire de patron me propose, en me réglant ma paye à la fin d’août, quelques
jours de congés à l’œil en Angleterre avant de retourner m’enfermer au bahut des riches, je
répercute la proposition à mon paternel, en insistant bien sur le caractère patronal de cette
initiative, et que ma foi je m’en remets à l’autorité…en fait il s’agit d’accompagner comme
aide chauffeur un routier de la Grenobloise de Transports qui, avec un fourgon frigorifique,
doit charger 20 tonnes de pêches tardives à Arles, les livrer dans la banlieue de Londres, puis
charger deux tonnes de foie frais et les décharger sur Marseille au retour. Je ne me préoccupe
pas de savoir de quels foies il retourne. A la tonne, de toute façon, ce ne peut être que
massivement dégueulasse. L’aller – retour doit durer quatre jours, l’aide chauffeur prévu
initialement a une cheville foulée, je n’ai pas le permis vu mon âge et cela n’a aucune
importance. Il ne s’agit pas de travailler, mais de profiter des réservations déjà faites et
réglées, passage en ferry depuis Dieppe, hôtels en Angleterre, frais de repas pris en charge,
etc…Papa fait merveille, il donne son accord immédiatement, fournit au commissariat de
police en moins de 24 heures les autorisations parentales me permettant de quitter le territoire
et je me retrouve à Londres en deux temps trois mouvements.
Mon patron d’un été a été habile sur ce coup là. Il connait de longue date papa, il a bossé
avec lui dans le temps et il connait sa propension à étouffer la liberté de tous ceux qu’il aime.
Monsieur Viteglio, puisqu’il faut le nommer, a été sensible à mes débordements printaniers
qu’il met sur le compte d’une jeunesse innocente et inexpérimentée, juste un mauvais moment
indispensable à passer.
J’ai du le décevoir depuis : j’agissais de son point de vue n’importe comment car j’étais
nécessairement un jeune con, mais il suffirait de laisser faire le temps. Ce patron – là en deux
mois m’a beaucoup appris sur la nature humaine, sur la lâcheté et la roublardise des hommes
et des femmes soumis à une hiérarchie ou en attente de salaire, il m’a fait aussi découvrir ce
qui était mon paysage, la Méditerranée, et tout ce que les quartiers de la Joliette et du Panier
comptaient de restos et de bistrots sympas, et il m’a fait aimer ma ville, Marseille, dont il était
pétri jusqu’à la moelle des os, depuis le sommet de son crâne jusqu’à l’extrémité de sa queue,
dont il faisait un usage multiculturel, pluriethnique et tout à fait cosmopolite, mais il s’est
trompé du tout au tout en ce qui me concerne. Je n’ai pas changé d’un iota. En vieillissant, je
suis simplement devenu vieux con.
Mon habile patron a fait simultanément une autre proposition à mon père : je pouvais
embarquer pour trois ou quatre mois sur un cargo, destinations Le Pirée, Istanbul, Beyrouth,
Alexandrie, retour Marseille au plus tard à la Noël. Tout heureux d’éviter ce voyage bien
tentant mais qui me faisait ipso facto sortir du circuit scolaire, Papa n’a pas hésité un seul
instant à choisir entre deux maux, le moindre. Papa est de toute façon sincèrement convaincu
que les voyages, entre deux coups de pied au cul, trois paires de claques et tout un catalogue
d’interdictions, forment la jeunesse.
Rien de particulier à signaler sur le voyage Marseille – Arles – Dieppe – Londres, juste ma
surprise à la découverte du niveau de corruption des douaniers français, surtout à Dieppe.
Pour revenir sur Marseille cela est plus délicat, une grève de dockers britanniques nous
interdit l’accès aux quais plus d’une semaine, nous contraint à renoncer au transport de foie
vers le continent, zut j’aurai bien aimé vérifier de mes propres yeux que deux tonnes de foie
prennent autant de place dans le fourgon frigorifique que vingt tonnes de pêches. Les rapports
entre chauffeurs anglais, français ou espagnols, ce n’est vraiment pas de l’internationalisme
prolétarien, disons plutôt de la bêtise crasse survoltée par un chauvinisme outrancier et un
égoïsme à jamais indépassable. Bof, je ne suis pas venu pour ça, j’espère simplement que du
côté des dockers, ça se tient un peu mieux. Puis un incident merveilleux, un incident comme
je ne l’aurai pas rêvé, des crachotements dans le moteur survenus au sortir de Paris obligent
mon transporteur à changer de programme. En téléphonant à son patron, il convient de
s’arrêter à Lyon où nous arriverons vers dix heures du matin pour une révision mécanique à
durée indéterminée. Pour que je me rapatrie sur Marseille, je dois me présenter à six heures le
lendemain matin au marché d’intérêt national où un petit camionneur transportant des
cagettes de raisin et en contrat avec la Grenobloise me prendra en charge pour le retour au
bercail.
Bien malgré moi, et déjouant tous les calculs parentaux, je me retrouve à Lyon, ma ville
bénie de noir et de rouge, pour une grosse vingtaine d’heures, de quoi changer le monde, au
gré de mes vives impatiences du moment. Laissant au chauffeur le soin de prévenir mon ex-
patron et mes parents de ce fâcheux contretemps, je ne perds pas une minute, il y a fort à
faire, n’ai - je pas lu dans la presse parisienne qu’à peine vingt-quatre heures plus tôt, en
Armorique, un jeune apprenti ouvrier de mon âge qui a laissé pousser ses cheveux d’une
façon intolérable pour son père et surtout pour le contremaître de son usine s’est heurté aux
quolibets de sa hiérarchie familiale et professionnelle, qui le traite tantôt de fillette, tantôt de
pédale. Obligé de passer au coiffeur pour éviter et d’être mis à la rue par un père
intransigeant, certainement gaulliste, comme papa, et à la porte de l’usine, par un petit chef
débile, certainement socialo-communiste, comme il se doit, le garçon s’exécute donc, sens
propre et sens figuré. Il se fait raccourcir les cheveux pour atteindre une longueur compatible
avec les intérêts de l’Etat et du Grand Capital conjugués au Respect de la Piété Filiale et du
Puritanisme syndicalo-communiste, et le lundi matin, à l’aube, à la reprise du boulot, au
milieu de la cour de l’usine, sous les yeux du contremaître triomphant, il imbibe ses vêtements
d’essence et s’immole par le feu.
Oui, il y a fort à faire, de toute urgence, et le monde a besoin de moi pour procéder à sa
remise en ordre. Quelques jours plus tôt l’union soviétique a commencé à assassiner le
printemps de Prague, et là-bas aussi un jeune meurt par le feu tant il veut témoigner de son
amour de la vie. Il faut que je passe là-bas aussi, taper sur l’épaule à Dubcek, lui glisser à
l’oreille « t’en fais pas mon vieux, je reviendrai un jour et on s’embrassera en fêtant la liberté
retrouvée, n’écoute pas les media qui disent à l’Ouest que tu es un homme fini, un faible,
voire un incompétent, c’est l’Union Soviétique qui est une vieille putain fanée, les faux -
communistes des maquereaux vautrés dans leur mensonges et t’accroches pas non plus à l’
Occident, n’en a plus pour longtemps, à bientôt, camarade, le monde va changer de base,
compte sur moi et sur mes potes, nous on t’oublie pas ».
Redevenu lyonnais par incidences d’ennuis mécaniques non prémédités, je me précipite donc
au domicile de Jacqueline, dont je sais l’attitude conciliante des parents.
Jacqueline, ma petite copine de classe, laide comme on sait l’être quand on s’en fout et
intelligente, fine et belle d’esprit, et de cuisses un peu aussi, comme jamais ne le fut une
princesse, rouge, ou bleue, ou verte, qu’importe, Jacqueline est absente. Je compte sur elle
pour me filer les derniers tuyaux sur la révolution en marche sur les quais de Rhône et Saône
réunis. Sa sœur aînée, Martine, présente au domicile familial, m’invite d’abord à prendre une
bonne douche, puis un bon café et m’avertit que plusieurs de mes potes, pour préparer en
beauté le sabotage de la rentrée des classes, se retrouvent le soir même chez Patrick. J’ai
côtoyé Patrick au lycée, un garçon très gentil, un peu plus âgé que moi, mais qui ne s’est pas
beaucoup engagé à nos côtés, un peu trop individualiste. Et qui m’irrite parce que sa
désinvolture naturelle, ses cheveux blonds très ondulés, ses yeux bleus immenses et ses
habiletés au basket et au handball lui attirent un nombre de succès féminins sans commune
mesure avec ses mérites révolutionnaires. Cela dit il y aura Jicé, le guitariste fou qui fut un
très très grand copain. Le serait resté s’il n’avait choisi quelques mois plus tard de sauter à
pieds joints dans une cage d’escaliers depuis un septième étage pour explorer la trop grande
place du vide dans sa vie. Il y aura Dany, avec son profil de poseur de bombes, mon pote à
jamais, il y aura surtout la toute menue Sylvie charnelle et pétillante, ils seront tous de la
partie. Connaissant mes penchants mais qui les ignore à l’époque, si ce n’est Sylvie elle-
même, Martine croit bon de me prévenir que ma promise ou du moins ma très attendue
fréquente depuis peu un beau gosse, un Espagnol, tout bronzé, l’œil noir, anarchiste, tout
frétillant comme elle, mais qu’importe. La soirée, ou plutôt la nuit, est prévue à Saint – Cyr au
Mont d’Or, chez les parents de Patrick .Ceux-ci sont propriétaires de plusieurs bars ou
restaurants dans la région lyonnaise, ils sont encore actuellement en vacances, et leur mignon
pavillon particulier, planté au milieu d’un parc sur les hauteurs rhodaniennes sera tout à nous,
une joyeuse bande d’une quinzaine de garçons et filles. Martine ne sera pas des nôtres, elle a
près de vingt- deux ans et d’autres fréquentations que notre bande de petits jeunes. Elle se
propose de m’accompagner d’un coup de voiture chez Dany, qui trouvera bien un moyen de
me faire accepter chez Patrick, nous n’avons pas trop de souci à ce sujet, bien que moi je ne
sais pas à l’époque témoigner beaucoup d’amitié aux fils de vrais bourges, et Dany trouvera
aussi une astuce pour quitter le centre-ville et monter jusqu’à Saint – Cyr sans trop de marche
à pied.
Dany, d’un an mon aîné, est tout heureux de me retrouver, un peu moins sa mère qui tient à
mon encontre un raisonnement inversement symétrique à celui de mon père à l’égard de son
fils, et nous voilà partis, malgré l’interdiction maternelle, la vieille veut me confisquer ma
carte d’identité, téléphoner aux condés et trouver où joindre mes parents pour les prévenir que
le diable est chez elle. Nous nous évadons de chez Dany par la fenêtre de sa chambre, située
fort heureusement en rez-de-chaussée sur rue, à l’opposé de la chambre de sa mère, qui
pendant toutes ces années ne se douta jamais de rien, mais redouta toujours le pire. Elle n’a le
choix en fait qu’entre l’amour de deux fils, l’un diplômé supérieurement d’ethnographie et
réfugié ad vitam aeternam dans l’apprentissage du Quechua, l’autre, Dany, qui de son
physique eut fait mourir de peur Raspoutine s’il l’avait croisé au coin d’une rue de Moscou à
l’aube d’une révolution. Moi, son profil de tueur à la bombe cachée sous cape, son allure
d’assassin au poignard toujours aiguisé, ses grands cris quand il débite des poèmes de
Maïakovski me ravissent. Il a de la broussaille au dessus de l’œil, ses joues sont creuses et
ses pommettes si saillantes qu’elles projettent des ténèbres profondes sur tout le bas de son
visage, la peau de son front, son menton et jusqu’à son oreille triste semblent sortir de
l’archive photographique d’un bagne de Troisième République, tout en lui est assassin, et il y
a tant de meurtres à commettre pour que le monde vive ! Ah, si la chambre de Dany ne s’était
trouvée en rez – de –chaussée, et sa mère un peu sourde, la face du monde eût été changée !
Dany ayant conservé ses habitudes depuis deux mois que je l’ai abandonné, nous suivons
quelque chemin aux haltes multiples dans des bouchons qui n’existent plus aujourd’hui, j’ai
vu récemment la plupart d’entre eux remplacés par des fast-foods ou des cybercafés, les pots
de beaujolais coulent à flot , entre deux fromages de chèvre et quelques saucissons, enfin les
fromages de chèvre et les saucissons c’est plutôt sur la table des autres, parce que nous le
pognon, c’est pas tout à fait ça, faut se concentrer sur l’essentiel, et je dois dire aussi que nous
sommes très excités à propos du Guatemala, parce que quelques étudiants y ont été fusillés
par la police quelques jours plus tôt, et qu’un prêtre rouge, c’est à dire un prêtre, y est mort
sous la torture, en présence de quelque distingué observateur yankee diplômé de West Point.
Parce qu’aussitôt on passe au Local Culturel, Rue Voltaire, la bien nommée, l’épicentre de
toutes mes débauches politiques antérieures, on y fait l’union sacrée avec trois bouts de
trotskistes toujours prêts à en découdre, dès qu’il s’agit de confondre dans le même panier à
saloperies les stals et la C.I.A., c’est à peu près là tout ce qu’ils ont de sympathiques, ces
branleurs de trotskistes et on se retrouve à nuit tombée devant un bâtiment identifié par la
police secrète de la IVème Internationale comme un vague consulat du pays incriminé, avec
quelques pots de peinture blanche et des grands pinceaux. Dany et moi, désespérément
minoritaires, je rappelle que les trotsk étaient trois, avons intégré sans rechigner l’organisation
militaire proposée, nous sommes chargés à un bout et l’autre de la rue de faire le guet et de
siffler trois fois dès qu’ un flic montre le bout de son nez, et trois pinceaux sont répartis entre
nos trois alliés d’un soir, le rôles sont bien distribués, le premier doit écrire en grandes lettres
majuscules « A BAS LE », le second un peu plus bas est chargé d’inscrire
« GOUVERNEMENT », et le troisième a la lourde tâche d’inscrire « GUATEMALTEQUE ».
Nous avons vu grand, à la dimension des crimes commis et de notre colère, et chaque lettre
tracée doit mesurer un mètre de hauteur et au moins trente centimètres de large, mieux que les
cocos quand ils inscrivent partout « paix au Vietnam », les cons, alors qu’il s’agit d’en créer
au moins deux, voire trois, de Vietnam, et encore, c’est un minimum, presque du défaitisme
que d’en prévoir si peu.
Le problème intervient quand le troisième trotskiste au bout de la chaîne interrompt sa
décoration murale pour nous interpeller, « eh, ça s’écrit comment, guatémaltèque ? », une
discussion s’ensuit entre les trois acolytes, Dany et moi peu à peu nous rapprochons pour
apporter notre contribution idéologique, avec deux lignes bien opposées, l’irrespect
nécessaire de l’ orthographe bourgeoise en ce qui me concerne, la nécessité prolétarienne
d’une lisibilité de nos slogans pour les masses à éduquer en ce qui concerne Dany, bref
j’avoue dans la discussion avoir de rage filé un coup de pied dans un pot de peinture qui
s’écrase sur le trottoir. Dany, surpris, aidé par la nuit venue et le vin précédemment bu, croit à
une agression extérieure, lâche ses trois coups de sifflets, notre commando se disloque
aussitôt. Moi, tremblant face à la possible agression fasciste, à plat ventre sous une voiture,
essaie d’identifier d’éventuelles chaussures de cognes, alors qu’il ne s’agit à hauteur de mes
yeux que des panards de Dany venu me récupérer l’alerte passée et les trotskistes enfuis. Nous
décidons aussitôt d’aller continuer la révolution ailleurs, c’est-à-dire chez Patrick, qu’ en
désespoir de cause nous appelons au téléphone et qui ne fait aucune difficulté, malgré son très
jeune âge, son absence de permis et son état d’ébriété avancée pour venir nous chercher au
volant d’une deux chevaux familiale, remontant ainsi de quelques degrés dans mon estime
militante. C’est à minuit passé que nous pénétrons dans le pavillon déjà joyeusement colonisé
par la plus jolie bande de gauchistes ivres que je n’ai jamais rencontrée. Je dis jolie, parce
qu’elle était là, la Sylvie.
Point de H chez nous pour dresser le décor, pas encore de L.S.D., que du vin rouge pour
arroser nos drapeaux noirs, à Lyon nous avons le choix et le pot est une vraie religion laïque,
Côtes du Rhôn septentrionaux, Beaujolais, Côtes – Rôties, Saint – Joseph, que de bons et
liquides souvenirs, avec beaucoup plus d’adeptes que tous les autres opiums du peuple. Et à
quoi s’occupe tout ce petit monde ? Ma mémoire me fait sans doute défaut pour l’affirmer
haut et fort, mais c’est à peu près certain, mis à part Jicé avachi sur sa guitare pour nous
beugler comme à l’accoutumée avec un talent certain que quand il n’y a que l’amour pauvre
martin quelle misère une fille dans une robe de cuir les bourgeois c’est comme les cochons,
tout le reste de l’équipe est penché, faute de pouvoir se tenir bien debout, sur une montagne de
bédés, et je crois que la vedette de la soirée est tout simplement un nommé Astérix dont pour
ma part je ne m’étais jamais trop préoccupé. Il faudra que je vérifie les dates d’édition, est-ce
bien ce petit gaulois à la Goscinny et à l’Uderzo qui mobilise ainsi notre clique ?
Jicé quant à lui se gratte le ventre comme il l’a toujours fait, même sous les grenades
lacrymogènes, même en garde à vue, même au pieu avec une copine, il s’isole derrière sa
guitare, nous distribuant du bonheur à coup de chansonnettes, avec son grand visage vide, sa
bouche sans lèvre et sans menton, ses yeux sans regard, où était-il déjà mon copain, cet ami ?
A le dévisager on ne voyait que son côté pas là, à l’écouter, on crevait de joie. Il nous était
jubilatoirement absent.
Je profite des lectures collectives de B.D. pour tenter d’ approcher Sylvie, bien là, bien
pétillante, mais très accrochée à son Espagnol, qui se vante un moment d’être l’auteur du coup
de feu qui à l’automne précédent a fissuré la porte vitrée du consulat d’Espagne, derrière la
Préfecture. Quel menteur, ou quel provocateur, mais interdit de le remettre à sa place, le
silence est une règle d’or dans notre petit groupe d’alors, un parti politique de trois adhérents,
moyenne d’âge quinze ans, tous unis dans la détermination à faire la peau à cette lope de
Franco, la faute à l’Espoir d’André Malraux qu’on avait lu en poche et visionné au ciné-club
du Lycée, juste une semaine après avoir vu Mourir à Madrid de Frédéric Rossif. Cet
Espagnol ce qu’il veut, c’est frimer devant Sylvie, a plus besoin de ça vue la place de sa main
dans la culotte de ma Sylvie, enfin la Sylvie est au peuple et à elle-même et la jalousie un
sentiment bourgeois, alors je me réfugie auprès d’une encore plus petite, plus menue et toute
timide et tendre comme un agneau tout juste né, Nini, inconnue jusqu’alors, arrivée de fraîche
date du campus de Grenoble, où les flics et indics de tout poil ont profité de l’été pour faire du
ménage. Nous nous régalons tous deux des aventures d’un petit gaulois et de son gros copain,
sans qu’aucune de mes deux mains ne s’éloigne des pages de l’album, et les mains de Nini
sont strictement occupées à tenir en équilibre nos deux verres de beaujolais, le seul érotisme
de la chose survient quand elle me fait boire, ma maladresse naturelle aidant, il en coule
partout, sur mon menton, dans ma poitrine, et en riant elle récupère à pleine bouche là où le
vin a dégouliné, elle a sans doute horreur du gaspillage, mais cela, disons, de mon point de
vue, au milieu de grands éclats de rire et sans aucune arrière pensée, si ce n’est d’éviter que le
ciel ne nous tombe sur la tête, ah l’érotisme grisant de Goscinny et Uderzo ! Et puis Dany, en
bon révolutionnaire professionnel, m’a alerté, chut, à propos du consulat d’Espagne, ne réagis
pas, l’espagnol, c’est sûrement un provocateur, un indic fasciste, surtout ne disons rien ne
bougeons pas, il faut dire que notre parti politique de l’automne précédent a éclaté à peine
passé la Noël, à cause d’une histoire de fuites d’informations ultra – secrètes quant à notre
nombre d’adhérents, une scission terrible a anéanti notre groupe de trois apprentis terroristes
dispersé désormais en trois tendances différentes, toutes soucieuses d’honneur et d’omerta
comme c’est pas permis, les origines corse, sarde et sicilienne des trois protagonistes
concernés ayant certes plus d’importance dans nos faits, gestes, attitudes et postures que le
marxisme-léninisme de l’époque de la pensée - Mao – Tsé – Toung.
Notre équipe va bon train, le rouge coule à flot, certains couples pensent à s’isoler, juste un
peu, pas trop, la pudeur est aussi un sentiment bourgeois, et il y a bien peu de discours, peu
d’échanges théoriques, il est encore trop tôt pour jouer entre nous aux anciens combattants,
trop tôt pour que nous nous retournions sur un proche passé auquel nous voulons tellement
conserver une allure de présent, nous sommes heureux bêtement d’ être là, se découvrir, se
toucher, se vérifier conformes à une certaine idée du bonheur, et faute de temps, pour une
seule nuit s’imaginer les uns les autres comme étant éternellement bien ensemble, voilà la
tâche révolutionnaire du moment, jusqu’à ce que vers les deux heures du matin, déboulent
parmi nous les deux frères aînés de Patrick, sympas au début, propets et cravatés un peu plus
que le tolérable, cherchant à s’isoler de nous, l’un faisant une fixation sur la petite Nini, qui
l’envoie balader, sans que j’y sois pour quelque chose, à moins que l’appropriation collective
des bédés propriété privée de l’un des aînés ne fut cause de tout, c’est l’empoignade entre
frangins, les aînés dépités de ne pouvoir tirer leur coup en puisant parmi nous, c’est du moins
comme cela que je vois les choses avec un manque d’objectivité évident, reprochent à Patrick
d’avoir introduit une bande de marlous au domicile familial, tout y passe, du dégueulis de l’un
abandonné dans les chiottes au salon enfumé de gauloises et de gitanes papier maïs, sans
oublier mes Celtiques de l’époque, pour faire comme dans une chanson de Léo et les P4 de
Dany, pour faire comme ceux qui ont pas de fric, et là il n’avait pas besoin de faire beaucoup
semblant, on s’en prend même à nos Pattogaz et à nos Clarks qui puent, on tente de nous
mettre à la porte, les connards de frangins emplumés, et un compromis est trouvé grâce à
Patrick que je ne songe pas sur l’instant à taxer d’opportunisme de droite, il sort d’un placard
quelques duvets et couvertures, et nous sommes autorisés à finir la nuit dans le jardin, à l’abri
de quelques arbres. Cela nous convient parfaitement, d’autant que Dany m’a fait dire que
Patrick, plein de prévenances pour ses hôtes, n’a trouvé qu’un duvet pour deux, il va falloir
faire des choix pour terminer la nuit, pour ma part je n’en fais aucun et me retrouve à l’abri à
l’intérieur d’un magnifique duvet bleu nuit, en compagnie d’une fille brune à laquelle je
n’aurais même pas rêvé, vu qu’elle a au moins vingt – deux ou vingt-trois ans, soit sept ans de
plus que moi, une sacrée frontière quand on est encore un merdeux, vu qu’elle a des cheveux
noirs à la Françoise Hardy, qui est pour moi comme la marque déposée de l’inaccessible, vu
qu’elle a des seins de femme, des vrais seins de vraie femme, vu que je ne lui ai pas adressé
la parole de la soirée, vu que j’ai bien vu qu’elle avait de la belle rondeur dorée de partout,
appétissante et belle comme on imagine que sont les femmes orientales, mille et une
nuitamment belle et vu que je découvre son prénom, Haïcha, après un bon quart d’heure de
palpations diverses, de léchages acrobatiques à l’intérieur du duvet avec enfouissement au
creux des cuisses, au sein des seins et réciproquement, prise de l’un par l’autre à pleine
bouche mon dieu cette bouche à Haïcha, belle et bonne et rebelle et rebonne et qui demande
qu’à m’avaler, à donner et à recevoir, à y retourner toujours, ô promesse de son cul, ô cul de
son cul, ô cul de mon cul, ô quels culs de nous mon dieu, oui, il y a des gens qui ont du cul,
d’autres se contentent d’avoir de la rate, de la vésicule biliaire, de l’arcade sourcilière, du
cartilage métatarsien, Haïcha, elle, a du cul, j’ai l’honneur d’aller d’abord tenter de l’explorer
par là, et fais bien, le temps m’étant malheureusement compté. Le plus simple n’est pas de lui
ôter son jean après combien d’enroulades combien de contournades combien de dérobades
qui dans le morne duvet se sont évanouies ! Quand je parvins enfin à la dépantalonner, tout en
la califourchant à croupetons, un retournement de situation me retrouve sur le dos, la tête
enfin à l’air libre. Je m’interroge sur la présence discourtoise d’un mâle non identifié, perché
sur une branche d’arbre juste au-dessus de nous, je n’ai pas le temps de gamberger pour
savoir si le voyeurisme est une vertu révolutionnaire ou une pratique petite – bourgeoise,
Haïcha me prend la tête à pleine mains pour me l’enfouir au plus près de son ventre, tout en
me disant « c’est rien t’occupe pas de lui», et c’est lors d’un nouveau sursaut vers l’air libre
après un moment d’apnée sublime que ce con perché debout sur sa branche commence à me
préoccuper plus que le con à l’instant échappé de ma bouche. Il est en train de bouffer une
grappe de raisins et il s’évertue, avec un calme olympien, comme si de rien n’est, à recracher
peaux et pépins non consommés, en visant soigneusement notre duvet d’un bleu pur. Cela
vaut à l’intrus une réflexion de Haïcha, du style « connard, tu pourrais partager », et celui-ci,
grand seigneur, s’exécute, nous balance à la volée une pleine grappe de raisins verts, des gros
grains délicieux dont nous faisons un usage sur lequel je ne m’étends pas, réservant des
explications plus détaillées sur la chose à l’occasion d’un autre récit. Cette présence, cette nuit
-là de mes seize ans pas encore atteints, d’une grappe de raisins au sein de notre couche
tumultueuse est sans doute à l’origine de quelques particularités dans mon érotisme personnel
fondamental, et aussi de ma vocation littéraire, car, hors du grain de raisin, point d’écriture,
foi de Renato, et par tous les poils arrachés un à un à la moustache de Staline, pour que le
Monde soit plus Libre, qu’ils allaient nous le faire croire, les salauds.
Chose dite, chose faite, le raisin est roulé, écrasé, croqué, léché, enfoui et récupéré à langue
que veux-tu, et c’est alors que, mis en confiance par l’âge avancé de ma compagnone, et
enfin parvenu le moment de la perte, je fais ici allusion à la perte de mon pucelage, nous
sommes tous deux inondés d’une pluie fine qui fait hurler Haïcha, « ah le con, que t’es con
qu’il est con le con », elle se dégage de moi, se roule dans l’herbe quelques mètres plus loin,
et finit par éclater de rire, alors que je devine tout simplement l’origine de l’ondée : l’intrus,
toujours lui, debout sur sa branche, a tranquillement ouvert sa braguette, apparemment plus
rapidement que Haïcha ne le fit pour la mienne, et urine sur nous, tout en sifflotant
l’Internationale, avec un rythme un peu rapide, toutefois.
Pris entre le dépit, et aussi un peu soulagé, d’avoir du interrompre illico presto l’acte somme
toute angoissant qui devait faire de moi un homme, coincé entre un peu de dégoût d’avoir été
ainsi trempé et aussi mal à l’aise face au fou rire de Haïcha, je m’apprête à interpeller le
gêneur, en cherchant désespérément quelque chose de drôle à dire ou à faire, l’humour étant
lui toujours révolutionnaire, quand Haïcha m’attire à nouveau vers elle, et me glisse à
l’oreille, tout en la mordillant, « c’est rien, laisse, c’est normal, c’est Marc, c’est mon mari ».
Horreur oui, j’appris ainsi que Haïcha a sacrifié au rite bourgeois du mariage, excusable vu
son grand âge et pour l’avoir fait avant mai 68, mais pour moi cette excentricité impensable
dans mon milieu me refroidit, et je m’en tire en annonçant que je vais prendre une douche à
l’intérieur, une douche d’eau chaude et de savon. Qui m’aime me suive. Personne ne
s’exécute.
L’autre continue à siffloter l’Internationale, perché sur sa branche. Il s’appelle Marc. Depuis
plus de cinquante ans, je n’ai jamais pu établir de relation de sympathie ou de confiance avec
quelque Marc que ce soit.
La jalousie est vraiment un sentiment petit-bourgeois, et l’urine chaude est son prophète.
J’ai à peu près réussi à ne jamais toucher de près à la jalousie. Je me sens peu concerné. Les
femmes que j’ai aimées et celle que j’aime encore aujourd’hui ont toujours été impossédables.
Mon honneur, on le place où on le peut, est de n’y avoir rien changé. Souffrir, ce fût, mais
autre chose.
A l’intérieur du pavillon je n’ai pas l’heur de prendre ma douche, je découvre ma Nini de tout
à l’heure en pleurs, avec plein d’une drôle de morve blanchâtre qui lui coule autour de la
bouche, qu’est-ce qu’elle fout à l’intérieur, alors que nous sommes tous passés au jardin, et
elle recroquevillée là sur un pieu, avec une bédé d’Astérix toute déchirée sur les genoux,
recroquevillée en position fœtale, m’attrapant au passage pour me demander de la ramener
d’urgence à Grenoble, qu’ elle m’aimera et que c’est pour la vie, on est tous dehors pourtant,
sauf les deux frangins à Patrick, merde, la Nini, les deux frangins à Patrick, qu’elle en a
besoin d’être aimée, à frais cueillir ses quinze ans et demi parmi ce grand amour qu’était son
beau visage, maintenant en pleurs et tout sali de tout ce crachat d’hommes, à ce moment – là
Martine a déboulé, elle s’est rappelé mon rencard de six heures du mat’ au marché d’intérêt
national, elle m’a fourgué dans sa bagnole, une vraie sainte cette Martine, elle a fini sa nuit
de fêtarde et a le souci de tout et de moi en particulier, j’ai juste le temps de lâcher une
adresse à Nini, celle d’un copain anar installé depuis peu à Grenoble, Géronimo, un copain
anar, un vrai de vrai, ouvrier pour de bon, ouvrier de naissance, pas un de ces connards
d’établis qui se la jouent prolo, un qu’avait le respect de tout et des êtres humains, il m’a
expliqué que lui il baisait pas une gonzesse quand elle avait ses règles, toujours question de
respect, et même les animaux il les respectait plus que tout, il militait contre les corridas, il
était même végétarien, est- ce que c’était vraiment un bon argument pour Nini ce matin-là,
bref je me retrouve bourlingué dans la bagnole à Martine, déposé devant le bahut qui doit me
reconduire à Marseille, avec la certitude d’avoir loupé beaucoup cette nuit- là, dans l’ordre et
le désordre, loupé un bout de ma Sylvie, loupé un départ pour Grenoble avec Nini sur mes
épaules à consoler pour la vie, loupé une sortie en beauté de dessous les arbres du jardin,
oublié de dire au revoir salut et fraternité à Dany et à Jicé, je pue le rouge et la sueur et la
pisse de l’autre, je n’ose même pas faire la bise à Martine pour ne pas trop m’approcher d’elle
en lui disant merci pour pas la dégoûter, avec la nette impression de louper là encore quelque
chose, un quelque chose aperçu à peine dans son dernier geste d’adieu, et quand mon
chauffeur routier me propose de pas me gêner et de plonger dans une cagette de raisin pour
me rafraîchir « si le cœur t’en dis à c’t’heure-ci », me rassasier et avoir l’air moins patraque,
je ne peux faire autrement que de vomir mes tripes, rien qu’à la vue de ces fruits mûrs, ce qui
le fait ricaner, « les jeunes ça tient plus l’alcool », non, mec, tu t’es gouré, ce n’est pas mon
bu de la nuit que je vomis ce matin-là sur la route qui me ramène à Marseille.
« Il faudra bien autre chose que du vin à cette révolution, donné plus que du jus de raisin
fermenté à cette révolution, éviter, dans un petit fleuve à usage de tout à l’égout, personnes
paumées, mauvais coups, d’un crime ou l’autre, personnes cassées, dans la mesure du
possible échapper, naviguer, tout peuple frelaté, sur un grand fleuve, fleuve de sang. »
Je pense à Jicé. Vautré sous les arbres, qui aurait pu, au moins une fois, une seule fois me
dire, me chanter, s’il n’avait étreint sa guitare en ronflant, il ronflait juste, le con, rythme et
tempo, me chanter, me crier, ou me susurrer, contrarier le texte d’origine, quand nous en
serons au temps des cerises, non, non, quand nous en serons au temps des cerises, nous
n’aurons plus, nous n’aurons, non nous n’aurons plus de chagrins d’amour. Je l’aurai cru, ou
fait semblant, il n’y a pas d’importance. Je ne suis plus concerné que par un rapide lever de
brume dans une aube urbaine maintenant bien affirmée.
Quand je lève enfin les yeux d’au-dessus de ma cagette, en essayant de me débarbouiller un
peu d’une main aussi sale que mon visage, en m’aidant d’une page déchirée de La Serpe d’Or
retrouvée collée à mon falzar, alors que la camionnette prend un grand virage pour rejoindre
une bretelle aérienne de l’Autoroute me conduisant vers le Midi, vers d’autres âges,
j’aperçois en face de moi, en contrebas, sur une façade grise d’une ville ô combien aimée et
amère pour longtemps, une mystérieuse inscription, soigneusement calligraphiée en grandes
lettres blanches d’au moins un mètre de haut dans une rue où ne siégea jamais aucun consulat
de quelque pays que ce fût, « A BA GOU GATEMA ».
Désormais presque seule au monde à en comprendre la signification, ma tête, au lieu de
prendre plaisir à cueillir au pied d’un frais matin charmant dans une joie tranquille le vierge,
le vivace et le bel aujourd’hui, ma tête, ma tête roule, bascule, hoquète, crachote, ma tête
s’écroule dans un cageot de fruits, des raisins verts, bien entendu.
Je ronfle jusque dans la banlieue de Valence, pas celle de la guerre d’Espagne, celle des
braves qui partent en vacances en empruntant la nationale 7.
Quand je débarque enfin à Marseille, la vérité est révolutionnaire, le mensonge est son
prophète.
Avec la participation italique des frères Brassens, Brel, Brassens, Ferré, Brel, Verlaine, Hugo, Ferré, Clément, Mallarmé. Et la mienne.